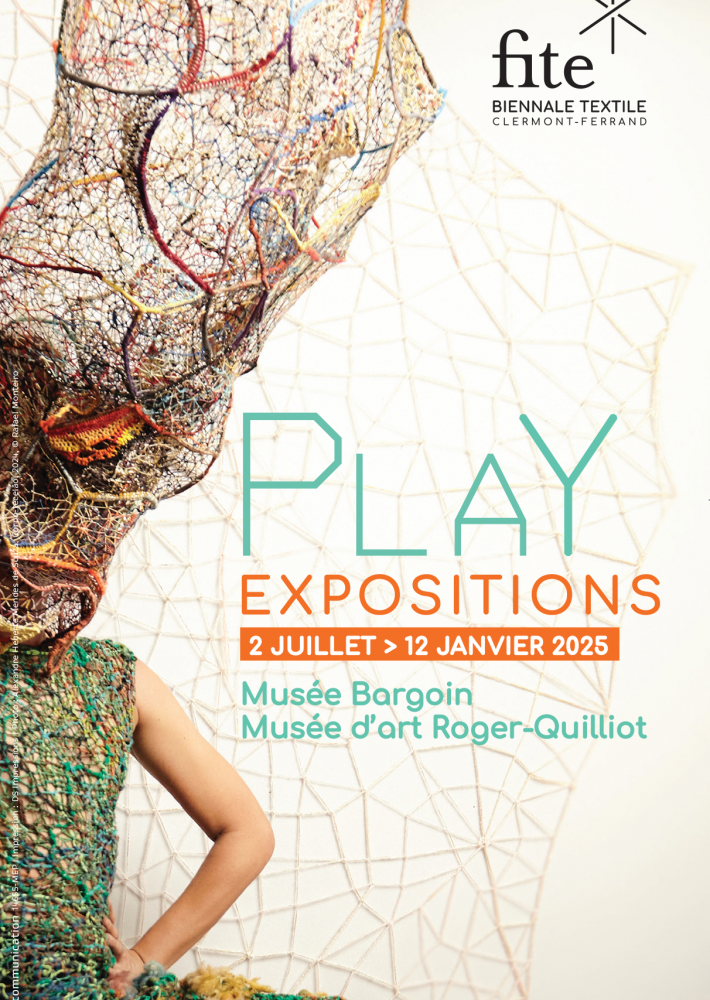Actus
D’où viennent les fleurs que nous offrons ? Léa Benoît, doctorante en géographie à l’université de Bordeaux Montaigne, nous ouvre les yeux sur ce marché aujourd’hui délocalisé en grande partie.
MEDIA
© Nicolas Parent PHOTOPQR/L’INDEPENDANT Photo via MaxPPP
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, faire le choix d’offrir des fleurs est loin d’opter pour un cadeau de proximité. À ce jour, 80 à 85 % des importations de fleurs en France proviennent de l’étranger, notamment des Pays Bas, du Kenya et d’Amérique du sud. Autrement dit, seulement 20% de la production est française.
La rédaction du Chantier revient sur l’évolution de ce marché auparavant européen, ainsi que sur les initiatives locales pour réinvestir cette filière. Comment faire évoluer nos pratiques de consommation et tendre vers une agriculture des fleurs plus durable ?
Pour répondre à ces questions, nous recevons Léa Benoît, doctorante en géographie à l’Université de Bordeaux Montaigne.
Aïcha Nouri